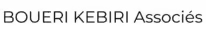Blog
Le droit au bénéfice

Introduction
Les droits financiers se matérialisent sous forme du droit de recevoir une part des bénéfices de la société. La création de la société repose sur l’objectif de partager les bénéfices potentiels, comme l’indique l’article 1832 du Code civil. Les droits financiers des associés incarnent cette intention, qu’ils s’expriment tout au long de l’existence de la société ou lors de sa dissolution.
Pendant la vie de la société
Les dirigeants des sociétés commerciales sont tenus de produire divers documents comptables, y compris les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes).
De plus, ils doivent élaborer un rapport de gestion décrivant la situation de la société au cours de l’exercice précédent et ses perspectives à venir. Ce rapport de gestion et les comptes annuels doivent être soumis à l’approbation des associés dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Les comptes annuels doivent également être publiés au greffe du tribunal de commerce et au BODACC, avec éventuellement des sanctions en cas de non-respect.
Les résultats annuels peuvent révéler un bénéfice distribuable, calculé en déduisant les pertes antérieures et les réserves obligatoires, conformément à la loi ou aux statuts, mais en y ajoutant un éventuel report bénéficiaire et la mise en distribution des réserves dont la société a la liberté de disposer.
Après l’approbation des comptes annuels et la confirmation de la disponibilité de fonds à distribuer, l’assemblée générale peut choisir de distribuer les bénéfices sous forme de dividendes ou de les maintenir en réserve pour renforcer la trésorerie de la société. L’idée sous-jacente est que les associés ont droit à la fois aux dividendes (1) et aux réserves (2).
1) Le droit aux dividendes
Les dividendes sont des montants que la collectivité des associés décide de prélever sur les bénéfices et de distribuer.
Toutefois, l’exercice de ce droit est conditionné par deux facteurs : la société doit réaliser des bénéfices, sans quoi la distribution serait incorrecte, car elle serait basée sur des bénéfices fictifs, à moins qu’elle ne concerne la distribution de réserves, c’est-à-dire d’anciens bénéfices épargnés.
De plus, les clauses statutaires prévoyant un intérêt fixe, c’est-à-dire un paiement aux associés indépendamment de l’existence de bénéfices à distribuer, sont interdites, sauf si elles sont indexées sur les bénéfices distribuables.
Qu’advient-il en cas de distribution de dividendes fictifs ? :
- Dans les sociétés par actions et les SARL, les dirigeants responsables de cette distribution s’exposent à des sanctions pénales. De plus, les associés peuvent être tenus de rembourser les montants distribués.
- Dans les autres sociétés, la jurisprudence considère que les dividendes sont de nature similaire à des fruits, de sorte que les associés de bonne foi peuvent les conserver conformément à l’article 549 du Code civil.
Il est également nécessaire que les associés prennent la décision de procéder à la distribution. Les dividendes ne sont juridiquement établis et accessibles aux associés qu’après la décision de les distribuer. Autrement dit, un associé devient créancier des dividendes à partir du moment où les associés constatent l’existence de bénéfices distribuables et décident de les répartir.
Le bénéficiaire des dividendes est donc la personne détenant les droits sociaux le jour de la décision de répartir les bénéfices (Cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27.745). Les dividendes, étant comparés à des fruits, naissent à partir de la décision collective de distribution des bénéfices et sont alors accessibles au propriétaire du bien frugifère ou à l’usufruitier, le cas échéant.
2) Le droit aux réserves
Les SARL et les sociétés par actions sont tenues de prélever une part des bénéfices de l’exploitation pour constituer des réserves, qui ne sont pas distribuables.
Les statuts peuvent également prévoir cette mise en réserve. En fin de compte, les associés ont toujours la liberté de décider de distribuer ces réserves, étant donné que la distribution de dividendes n’est pas obligatoire, sauf s’il y a abus de majorité.
Le droit aux réserves peut s’exprimer de plusieurs manières :
- Les associés peuvent décider à tout moment de procéder à la distribution de ces réserves au cours d’un exercice ultérieur.
- Pendant ce temps, la valeur marchande des droits sociaux augmente, ce qui permet aux associés de les céder à un meilleur prix.
- De la même manière, en cas d’augmentation de capital, la présence de réserves justifie une prime d’émission. Les souscripteurs doivent payer cette prime, mais elle n’entraîne pas l’attribution de droits sociaux pour un montant équivalent. Cette prime renforce les réserves de la société, préservant ainsi les droits des associés existants.
À la dissolution de la société
Une fois que tous les créanciers de la société ont été indemnisés, en cas d’excédent (appelé boni de liquidation), celui-ci est réparti entre les associés en proportion de leur participation dans le capital social, sauf dispositions statutaires particulières.
CONTACT
Vous avez des questions ? Nous sommes toujours prêts à échanger avec vous au sujet de votre entreprise, de vos projets, et de la manière dont nous pouvons vous aider.